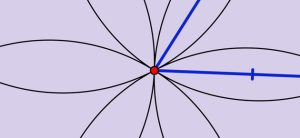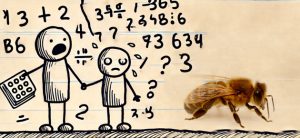La marquise et les savants de son temps

Le décès prématuré de la marquise du Châtelet en 1749, alors qu’elle met la dernière main à sa traduction et à son commentaire des Principia, l’œuvre maîtresse d’Isaac Newton (1642-1727, voir l’article), marque la fin d’une carrière scientifique qui a également débuté sous l’ombre tutélaire du grand savant anglais.
Quand elle se passionne pour la science en 1734, en effet, les théories newtoniennes sont particulièrement discutées en France. Et en partie grâce aux Lettres anglaises de son compagnon de fraîche date, Voltaire (1694-1778), qui paraissent en français cette année-là, après une édition anglophone publiée en 1733. Dans ce compte rendu très personnel d’un voyage en Angleterre effectué un peu auparavant, au cours duquel il avait assisté aux obsèques de Newton et s’était familiarisé avec les grandes lignes de son œuvre, Voltaire décrit pour le grand public tout ce qui distingue les théories newtoniennes des théories cartésiennes, qui ont alors la faveur des savants français (voir encadré).

Voltaire par Nicolas de Largillière, autour de 1720.
[encadre]
Voltaire newtonien
Dans ses Lettres écrites de Londres sur les Anglois (1734), dites encore Lettres anglaises ou Lettres philosophiques, Voltaire décrit ainsi l’opposition entre sciences françaises et britanniques :
« Un Français qui arrive à Londres trouve les choses bien changées en philosophie comme dans tout le reste. Il a laissé le monde plein, il le trouve vide. À Paris on voit l’univers composé de tourbillons de matière subtile ; à Londres on ne voit rien de cela. […] Chez nos cartésiens tout se fait par une impulsion qu’on ne comprend guère ; chez M. Newton c’est par une attraction dont on ne connaît pas mieux la cause. À Paris vous vous figurez la Terre faite comme un melon ; à Londres elle est aplatie des deux côtés. […]
Je ne crois pas qu’on ose à la vérité comparer en rien [l]a philosophie [de Descartes] avec celle de Newton : la première est un essai, la seconde est un chef-d’œuvre. »
Aux côtés de la marquise du Châtelet, Voltaire rédigera plusieurs ouvrages d’inspiration newtonienne, dont les Éléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde (1738).
[/encadre]
De Maupertuis à Clairaut
En préparant son ouvrage, Voltaire avait pris contact avec celui qui, par son Discours sur la figure des astres (1732), avait ouvert le débat à l’Académie des sciences : Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759). Aussi, quand en 1734 la marquise du Châtelet décide de sérieusement comprendre les sciences de son temps, c’est tout naturellement qu’elle se tourne vers ce premier des newtoniens. Il sera presque aussitôt suivi par celui qui allait devenir le plus grand d’entre eux : Alexis-Claude Clairaut (1713-1765 ; voir aussi le dossier « Alexis Clairaut, géomètre des Lumières », Tangente 222, 2025).
Le parcours scientifique d’Émilie du Châtelet commence par l’acquisition des mathématiques élémentaires. Avec Maupertuis, les leçons prennent rapidement un tour très personnel. Il faut dire que le savant aime les femmes et possède l’art de les rendre folles, parfois littéralement (voir encadré). De son côté, mariée au marquis du Châtelet (1695-1765), en concubinage avec Voltaire, Émilie est une femme à l’esprit libre. Selon un témoignage du temps, elle n’hésite pas à se déguiser en homme et à monter seule à cheval pour rejoindre son professeur sur des sessions qui pouvaient durer de quatre heures du matin à midi.

Pierre-Louis Moreau de Maupertuis.

Alexis-Claude Clairaut.
[encadre]
Maupertuis et les femmes
Maupertuis rendra littéralement folle une jeune Suédoise, Christine Planström, venue en compagnie de sa sœur Elisabeth le rejoindre en France à la suite de l’expédition en Laponie. Selon un témoin du temps, elle est restée « à la merci de Maupertuis », qui en usa un temps « comme des choux de son jardin ». Son état mental étant devenu incertain, cette « Lapone » (comme on la surnommait improprement) finit les près de cinquante années qui lui restaient à vivre dans un couvent en Normandie.
Plus tard, expatrié en Prusse pour y refonder et présider l’Académie des sciences de Berlin, marié à une proche de la Reine, Maupertuis aurait fait enlever et enfermer à vie une femme malencontreusement tombée enceinte de ses œuvres, pour qu’elle n’ébruite pas l’affaire.
[/encadre]
Avec Clairaut, les choses paraissent plus sérieuses. De ses leçons, il tirera quelques années plus tard des Éléments de géométrie (1741) qui marquèrent l’histoire de l’enseignement. Plusieurs fois traduits et réédités, de même que ses Éléments d’algèbre (1746), ils se caractérisent par une approche très progressive, concrète et pragmatique des mathématiques.
Mais les deux hommes ne consacrent pas à la marquise autant de temps qu’elle le souhaiterait. À leur décharge, ils ont fort à faire à l’Académie des sciences. Le débat entre cartésiens et newtoniens bat toujours son plein et se cristallise sur la forme de la Terre : selon les premiers, notre globe devrait être légèrement aplati à l’équateur, selon les seconds, légèrement aplati au pôle. Pour trancher la question, il est décidé en 1735 d’organiser deux expéditions, l’une au Pérou, l’autre en Laponie. Maupertuis doit conduire la seconde, dont fait aussi partie Clairaut. Il faut se préparer, s’entraîner aux mesures et partir…
Dans son château de Cirey
Parallèlement, la marquise du Châtelet et Voltaire quittent Paris pour s’installer à Cirey en Champagne. À défaut de pouvoir y attirer Clairaut et Maupertuis, trop occupés, elle y accueille temporairement, fin 1735 puis en octobre 1736, un de leurs amis italiens, Francesco Algarotti (1712-1764). Ce newtonien voyageur, un temps pressenti pour le voyage en Laponie, y met au point un ouvrage de vulgarisation qui connut un grand succès, Il Newtonianismo per le dame (« Le Newtonianisme pour les dames », 1737), dont le frontispice représente la marquise se promenant avec l’auteur dans les allées du château de Cirey.

Le portrait de la marquise du Châtelet conversant avec Algarotti
dans les jardins du château de Cirey, tel qu’il apparaît
au frontispice du Newtonianismo per le dame (1737).

Francesco Algarotti, peint par Jean-Étienne Liotard en 1745.
En l’absence de ses deux maîtres, la marquise s’intéresse seule à la physique et prend même son envol en participant, tout comme Voltaire, au concours organisé par l’Académie des sciences qui porte en cette année-là sur la nature du feu. Son mémoire ne sera pas primé, mais tout de même publié, occasion pour elle d’en adresser un exemplaire le moment venu à l’un des gagnants, Leonhard Euler (1707-1783). Ce dernier recevra aussi plus tard les Institutions de physique (1740) qu’il lira avec attention comme le prouve la lettre détaillée qu’il lui adressa en retour.
La marquise du Châtelet s’attelle justement à la rédaction de ce livre. Une première version est prête en 1738, mais s’étant formée seule, consciente de ses lacunes, elle ressent toujours le besoin de se faire encadrer. Maupertuis et Clairaut, revenus de Laponie, peuvent certes l’aider ponctuellement par courrier, mais sont trop affairés pour lui être vraiment utiles. Finalement, au retour d’un voyage à Bâle chez l’illustre famille scientifique des
Bernoulli, Maupertuis passe par Cirey et lui présente un ancien élève de Jean I Bernoulli (1667-1748), Samuel Kœnig (1712-1757), dont le nom restera plus tard associé au principe de moindre action.

Samuel Kœnig.
Le temps des orages
La marquise le prend à son service. Au début tout se passe bien, d’autant que ce nouveau professeur lui fait découvrir la métaphysique de Leibniz, une matière qui l’enchante tellement qu’elle décide de l’ajouter à ses Institutions. Mais le jeune homme, semble-t-il assez imbu de sa personne, ne s’estime pas traité comme il le mérite. On croit comprendre qu’il n’aime pas la viande bouillie qu’on lui sert tous les jours, et surtout qu’il n’est pas assez payé. La séparation se fait dans la douleur, et dans la vengeance de la part de Kœnig, qui déclare à qui veut l’entendre qu’il est le véritable auteur du livre de la marquise.
Mais ce n’est pas le cas, et la marquise va pouvoir s’en justifier de deux façons grâce à son interaction avec un autre savant : Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771). Bien avant l’arrivée de Kœnig alors qu’elle étudiait seule, elle avait tiqué sur un mémoire publié par cet académicien dans le cadre du célèbre débat des forces vives. Encore peu confiante en elle-même, elle avait demandé l’avis de Maupertuis, qui l’avait confortée dans son point de vue. Elle avait en conséquence exprimé sans détour son opinion dans ses Institutions – un passage qui n’a donc pas pu être écrit par Kœnig. Mais surtout, à la parution du livre, Kœnig parti depuis longtemps, Dortous de Mairan réagit dans une lettre publique défendant sa position. Lettre à laquelle la marquise du Châtelet répond par une cinquantaine de pages rédigées et imprimées à la vitesse de l’éclair – trois semaines –, de sorte, écrit-elle, « qu’on n’a pas pu me disputer [cette réponse] et on m’a rendu les Institutions ».
Dans l’intervalle, la mise à pied de Kœnig aura réussi à ternir un temps les relations de la marquise avec Clairaut. Elle est en effet très fâchée que ce dernier, croyant sans doute bien faire, ait proposé son protégé devenu ennemi comme membre correspondant de l’Académie des sciences. Ils se rabibocheront toutefois à la faveur de la parution proprement dite des Institutions, et, après avoir lu le livre, Clairaut suggèrera quelques corrections mineures dont la marquise tiendra compte pour la seconde édition.
L’expulsion de Kœnig la brouillera aussi avec Maupertuis. Car de nouveau sans professeur, elle s’en cherche un autre et jette son dévolu sur Jean II Bernoulli (1710-1790). Après tout, son père, le patriarche Jean I, avait jadis donné des leçons au marquis de l’Hôpital (1661-1704) qui avaient débouché sur la célèbre Analyse des infiniment petits (1696). La marquise lui fait une proposition généreuse – comprenant un domestique pour lui tout seul –, lui laisse miroiter une place de correspondant à l’Académie… Mais chargé de jouer les émissaires, Maupertuis trahit sa mandatrice en déconseillant à Jean II Bernoulli d’accepter l’offre. D’où la brouille quand la marquise l’apprendra. Grâce aux bons offices de Voltaire, cependant, ils finiront eux aussi par se réconcilier quelques mois plus tard.
Même si Jean II Bernoulli ne devint pas son professeur, la marquise du Châtelet restera en contact avec lui jusqu’à sa mort. Quand elle cherchera un exemplaire de l’édition de 1726 des Principia de Newton, par exemple, il lui fera parvenir l’exemplaire de son père. En une autre occasion, c’est par lui que transitera un portrait de la marquise du Châtelet qu’elle juge elle-même « le plus vilain du monde ».

Jean I Bernoulli.

Jean II Bernoulli.

Le portrait de la marquise du Châtelet « le plus vilain du monde »
ou qui « fait frayeur », selon ses propres expressions.
Transmis par elle à Jean II Bernoulli, il orne une courte biographie en langue allemande publiée dans le Bilder-Sal heutiges Tages lebender (1745).
Les Institutions comme carte de visite
La parution des Institutions, soit qu’elle adresse un exemplaire du livre, soit qu’elle en reçoit des réactions, est l’occasion pour elle d’entrer en contact avec divers savants, plus ou moins connus, plus ou moins oubliés, comme Jean-Pierre de Crousaz (1663-1750), James Jurin (1684-1750), Pieter van Musschenbroek (1692-1761) ou Christian Wolff (1679-1754). Sa polémique publique avec Dortous de Mairan, qui était alors secrétaire de l’Académie des sciences, assoit sa position dans le paysage scientifique de l’époque. À l’occasion de divers passages à Paris, elle se rend à des séances publiques de l’Académie des sciences – comme en 1741 ou encore en 1747 pour écouter Buffon, par exemple. C’est d’ailleurs lors de ce séjour qu’elle rencontre Gabriel Cramer (1704-1752), le savant genevois connu par la règle qui porte son nom, permettant de calculer le déterminant d’une application linéaire.
Sa nouvelle connaissance scientifique post-Institutions la plus marquante est toutefois le père François Jacquier (1711-1788), qui, avec le père Thomas Le Seur (1703-1770), a publié entre 1739 et 1742 une édition latine annotée des Principia de Newton. Elle l’accueille à Cirey en 1744 et entretiendra avec ce religieux installé à Rome une correspondance suivie. Il lui enverra par exemple de la poudre de Ouakaka (ou Wakaka), une sorte de cacao aromatisé à la vanille et à la cannelle, entre autres ingrédients, aux vertus paraît-il fortifiantes, qu’elle recherche depuis longtemps. C’est aussi lui qui, en 1746, fera en sorte qu’elle soit membre de l’Institut de Bologne, l’une des rares académies des sciences à accepter les femmes. Elle lui fera part de son côté de l’évolution de sa propre édition des Principia.

Le château de Cirey.
Retour à Newton… et Clairaut
Car la marquise décide de traduire les Principia en français puis de les assortir d’un commentaire. Si elle expédie assez facilement la première partie du projet, rédigée entre 1745 et 1746, imprimée dans la foulée, elle bloque sur la seconde. Et cela à cause de cet animal de Clairaut qui, en 1747, ne trouve rien de mieux que de suggérer de modifier la loi de la gravitation universelle. Il faut dire que personne, pas même Euler, pas même d’Alembert (1717-1783), ne parvient alors à concilier le mouvement observé de la Lune et celui déterminé par le calcul sous l’hypothèse de la loi du carré. Tirant les conclusions qui s’imposent, Clairaut propose donc d’ajouter des termes d’ordre supérieur à ladite loi, et demande un délai pour préciser la forme desdits termes. Comment dans ce contexte la marquise peut-elle rédiger un commentaire sur les travaux de Newton ?
Elle s’accorde une pause, tombe amoureuse d’un jeune homme, Jean-François de Saint-Lambert, et même enceinte, tandis que Clairaut, toujours à ses calculs, comprend finalement « ce qu’il avait eu tort de négliger ». Il annonce en mai 1749 à l’Académie des sciences avoir enfin accordé mouvements réel et calculé de la Lune, signant au passage la deuxième grande validation des théories newtoniennes – après celle de la Terre aplatie aux pôles par les expéditions au Pérou et en Laponie. Il demande toutefois un délai pour achever son travail, délai fatal au commentaire de la marquise, qui meurt des suites de son accouchement en septembre de cette année-là, le laissant donc globalement inachevé.
C’est encore Clairaut, devenu au fil du temps le principal conseiller scientifique de la marquise, qui assurera la publication posthume de la traduction et du commentaire des Principia. Celle-ci intervient à point nommé une dizaine d’années plus tard, en 1759, alors que la comète de Halley pointe le bout de son nez, à la date prévue par une équipe de calculateurs dirigés par Clairaut – toujours lui ! Ce retour marque la troisième et dernière grande validation des théories newtoniennes.
Autant dire que ces validations ont rythmé jusqu’à la carrière scientifique posthume de la marquise du Châtelet !

Morceau de la tapisserie de Bayeux montrant la comète de Halley
observée par Guillaume le Conquérant en 1066.
Olivier Courcelle est docteur en mathématiques, fondateur et administrateur de clairaut.com, un site Web complet consacré à Alexis Clairaut.