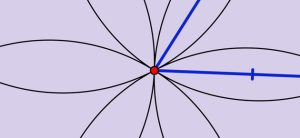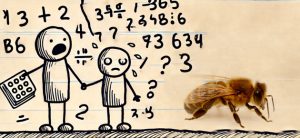Une savante philosophe

L’itinéraire intellectuel de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil (1706-1749) commence avec l’éducation que choisit de lui donner son père (études classiques, sciences, littérature et philosophie), par sa fréquentation du cercle littéraire initié par celui-ci dans leur hôtel particulier parisien où elle rencontre Fontenelle (1657-1757) et Voltaire (1694-1778) avec lesquels elle parle de science. Cet itinéraire se poursuit avec ses premières « leçons » de newtonianisme prodiguées par Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759) puis Alexis Clairaut (1713-1765), tant qu’elle est à Paris.

La marquise du Châtelet peinte par Nicolas de Largillière.
Une savante à part entière
Une fois installée au château de Cirey, en Haute-Marne, avec Voltaire à partir de 1735, elle rédige ses premiers travaux scientifiques. Elle assiste avec le philosophe à des expériences sur la propagation du feu qui conduiront à la rédaction, secrète (voir l’article), de sa Dissertation sur la nature et la propagation du feu écrite en 1738 pour répondre au concours lancé par l’Académie royale des sciences en 1737. Son mémoire ne gagne pas le prix mais jouira d’une grande reconnaissance puisqu’il sera peu après le premier texte publié par une femme de science dans les Mémoires de l’Académie royale des sciences. C’est dans une proximité intellectuelle avec Maupertuis, les Bernoulli, mathématiciens suisses de renom, ou encore Leonhard Euler (1707-1783), dans la fréquentation des textes du mathématicien et philosophe Christian Wolff (1679-1754) et du physicien hollandais Willem Jacob ‘s Gravesande (1688-1742), qu’elle rédige puis publie anonymement en 1740 les Institutions de physique. Une seconde édition remaniée, incluant une partie de sa correspondance avec le secrétaire perpétuel de l’Académie royale des sciences de l’époque, Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), paraît en 1742 sous son nom. Des accusations de plagiat, lancées par le mathématicien allemand Samuel Kœnig (1712-1757), l’ont rapidement conduite à se faire connaître comme autrice de ce texte. Adressé à son fils, ce texte apparaît à première vue comme un manuel de physique destiné à présenter les fondements métaphysiques de la physique moderne. Mais Émilie du Châtelet dans cet ouvrage propose d’une part une subversion du stéréotype de genre : dans l’avant-propos, renversant le dispositif du texte à succès de Francesco Algarotti, Le newtonianisme pour les dames (voir l’article), elle est la femme savante qui enseigne ce qui doit être su en physique par un jeune homme (voir encadré). D’autre part au lieu d’une simple exposition des principes métaphysiques de Leibniz (1646-1716) et de la physique de Newton (1642-1727) qui entérinerait un défaut de singularité philosophique, ce texte propose une philosophie de la science originale.
Willem ‘s Gravesande.
Pourtant, dans une lettre du 24 septembre 1740, le roi de Prusse Frédéric II écrit à son conseiller Charles-Étienne Jordan : « La Minerve vient de faire sa Physique, il y a du bon, c’est Kœnig qui lui a dicté son thème ; elle l’a ajusté et orné par-ci par-là de quelque mot échappé à Voltaire à ses soupers. Le chapitre sur l’étendue est pitoyable, l’ordre de l’ouvrage ne vaut rien ; il y a même de très grosses fautes, car dans un endroit elle fait tourner les astres d’Occident en Orient. Enfin, c’est une femme qui écrit et qui se mêle d’écrire au moment où elle commence ses études. » Cela témoigne de la difficulté d’être prise au sérieux pour une femme scientifique à l’époque. Heureusement, un tel commentaire est compensé, par exemple, par l’éloge qu’Euler lui réserve dans une lettre de fin 1741 / début 1742 : « Mais surtout le chapitre sur les hypothèses m’a fait le plus grand plaisir, voyant que vous combattez, madame, si fortement et si solidement quelques philosophes anglais, qui ont voulu bannir tout à fait les hypothèses de la physique qui sont pourtant à mon avis le seul moyen de parvenir à une connaissance certaine des causes physiques. J’ai été souvent en peine, lorsque le discours roulait sur cette matière avec des Anglais, de trouver des raisons convaincantes pour bien faire voir l’utilité des hypothèses, mais je n’ai jamais pu développer mes idées sur ce sujet d’une manière si claire que vous. »
[encadre]
La physique expliquée à son fils
« J’ai toujours pensé que le devoir le plus sacré des Hommes était de donner à leurs Enfants une éducation qui les empêchât dans un âge plus avancé de regretter leur jeunesse, qui est le seul temps où l’on puisse véritablement s’instruire ; vous êtes, mon cher fils, dans cet âge heureux où l’esprit commence à penser, & dans lequel le cœur n’a pas encore des passions assez vives pour le troubler. […] L’étude de la Physique paraît faite pour l’Homme : elle roule sur les choses qui nous environnent sans cesse & desquelles nos plaisirs et nos besoins dépendent. Je tâcherai, dans cet Ouvrage, de mettre cette Science à votre portée & de la dégager de cet art admirable qu’on nomme Algèbre, lequel séparant les choses des images, se dérobe aux sens, et ne parle qu’à l’entendement. Vous n’êtes pas encore à portée d’entendre cette Langue, qui paraît plutôt celle des Intelligences que des Hommes. Elle est réservée pour faire l’étude des années de votre vie qui suivront celles où vous êtes ; mais la vérité peut emprunter différentes formes, & je tâcherai de lui donner ici celle qui peut convenir à votre âge, & de ne vous parler que de choses qui peuvent se comprendre avec le seul secours de la Géométrie commune que vous avez étudiée. »
Émilie du Châtelet, Institutions de physique, extraits de l’avant-propos.

Une page des Institutions de Physique.
[/encadre]
Enfin, à la traduction des Principia de Newton (voir l’article), la seule complète en français existant encore à ce jour, il faut ajouter son Exposition abrégée du système du monde publiée en 1759 après sa mort. Il s’agit d’une présentation et d’une discussion de la physique newtonienne.
Des ouvrages critiques
À côté de ces textes majeurs pour l’histoire et la philosophie des sciences et pour compléter le portrait de cette philosophe savante, il faut mentionner d’autres ouvrages. Dès le milieu des années 1730, elle rédige une traduction libre et commentée de Lafable des abeilles de Bernard Mandeville (1670-1733), dont l’« avant-propos du traducteur » est souvent considéré comme son manifeste féministe : « Pour moi, j’avoue que si j’étais roi, je voudrais faire cette expérience de physique : je réformerais un abus qui retranche, pour ainsi dire, la moitié du genre humain, je ferais participer les femmes à tous les droits de l’humanité, et surtout à ceux de l’esprit ».
Elle écrit également entre 1744 et 1746 un texte de philosophie pratique, le Discours sur le bonheur publié après sa mort. Elle y écrit notamment sur l’importance de l’éducation pour les filles : « Il est certain que l’amour de l’étude est bien moins nécessaire au bonheur des hommes qu’à celui des femmes. Les hommes ont une infinité de ressources pour être heureux, qui manquent entièrement aux femmes. Ils ont bien d’autres moyens d’arriver à la gloire, et il est sûr que l’ambition de rendre ses talents utiles à son pays et de servir ses concitoyens, soit par son habileté dans l’art de la guerre, ou par ses talents pour le gouvernement ou les négociations, est fort au-dessus de [celle] qu’on peut se proposer pour l’étude ; mais les femmes sont exclues, par leur état, de toute espèce de gloire, et quand, par hasard, il s’en trouve quelqu’une qui est née avec une âme assez élevée, il ne lui reste que l’étude pour la consoler de toutes les exclusions et de toutes les dépendances auxquelles elle se trouve condamnée par état. »
Enfin, elle rédige un manuscrit qui prend désormais place dans la littérature de la philosophie clandestine, les Examens de la Bible, un texte de plus de mille pages qui est une critique virulente de la religion chrétienne sous couvert d’une lecture littérale de la Bible.
En lieu et place du soupçon constant et redoublé à l’égard de l’originalité du travail d’Émilie du
Châtelet, massivement présentée comme une traductrice, vulgarisatrice et plagiaire, il importe désormais de dresser les contours de sa philosophie des sciences.
Une véritable philosophe des sciences
Dans la première moitié du XVIIIe siècle en France, le champ scientifique est fortement polarisé autour d’une distinction qui admet elle-même de nombreuses nuances : d’un côté, une physique s’appuyant sur des principes métaphysiques qui s’inscrit dans le sillage plus ou moins fidèle de Descartes, et à cet égard, on lit souvent Leibniz ou Malebranche comme s’inscrivant dans cette filiation (ce qui est discutable, bien évidemment). D’autre part, une physique qui aurait pris acte du geste newtonien de mathématisation de la physique et qui sous le slogan de l’hypotheses non fingo congédierait les hypothèses de la méthode scientifique, ne s’appuyant désormais que sur la régularité phénoménale attestée par des expériences et traduite mathématiquement en lois.
Dans ce contexte, la position d’Émilie du Châtelet se révèle singulière en ce que, lectrice attentive de Newton, elle comprend que son rejet des hypothèses n’est en rien un précepte méthodologique de portée générale, c’est tout le sens du chapitre IV des Institutions intitulé « Des hypothèses ». Elle comprend également l’importance d’une preuve expérimentale du principe de conservation des forces vives (une notion de la physique de l’époque), c’est le sens de sa référence à ‘s Gravesande au chapitre XXI du même texte. Elle choisit ainsi d’élaborer une épistémologie mixte qui, sans renoncer aux principes métaphysiques, leur confère une fonction non pas fondationnelle mais régulatrice. Les principes métaphysiques (principe de raison suffisante tout particulièrement) ont une fonction méthodologique. La conséquence est d’importance pour identifier le type de certitude qu’a notre connaissance de la nature : une certitude physique qui intègre une réflexion très stimulante sur les limites de notre savoir. Elle écrit par exemple : « C’est ainsi qu’on peut et qu’on doit se servir de l’attraction comme d’une qualité physique, dont la cause mécanique est inconnue pour rendre raison d’autres phénomènes qui en résultent. Ainsi, on peut assurer par exemple, que le soleil attire les planètes et d’autres matières qui les environnent puisque les phénomènes le démontrent, pourvu qu’on ne fasse pas de cette attraction une propriété inhérente de la matière et qu’on ne détourne pas les philosophes d’en chercher la cause mécanique. Car ceux qui ne veulent point admettre dans la philosophie des miracles perpétuels doivent rendre raison des effets par l’essence des choses et par le mouvement. Et tout ce qui n’est point explicable par ces principes n’est point du ressort de la philosophie qui ne doit s’occuper que des effets naturels qu’on doit concevoir distinctement et expliquer intelligiblement. »

Portrait de la marquise par Marianne Loir.
Une place de choix dans les Lumières
Il faut dire un mot de la postérité d’Émilie du Châtelet et en particulier de la présence des Institutions de physique dans bon nombre d’articles de l’Encyclopédie. Cette présence est tantôt implicite quand, par exemple Formey ou d’Alembert reprennent sans la mentionner certains passages des Institutions ; tantôt présence explicite quand l’emprunt est clairement formulé : c’est le cas pour les articles « Continuité », « Espace », « Hypothèse », « Mouvement », « Pesanteur », « Repos », « Temps ». Il n’est pas exagéré de dire que les Institutions de physique constituent une dimension forte de l’épistémologie des Lumières telle qu’elle est transmise dans l’Encyclopédie. Indiquons enfin l’appréciation positive que lui adresse le savant Leonhard Euler dans une lettre laudative, la reconnaissance rapide qu’elle rencontre en Italie et en Allemagne : en témoignent la traduction en italien des Institutions dès 1743 et son élection à l’Académie de Bologne (l’une des rares académies à accepter les femmes à l’époque), tout comme la traduction la même année en allemand des Institutions encouragée par Wolff. Pour finir, elle est citée à plusieurs reprises par Kant, pour l’essentiel, dans ses travaux consacrés aux « forces vives ».
Émilie du Châtelet est donc bien une philosophe savante dont les travaux ne peuvent être réduits à l’image longtemps véhiculée d’une traductrice et vulgarisatrice des sciences de Leibniz ou Newton. A contrario, lui redonner la place qu’elle avait dans la communauté des savants du XVIIIe siècle conduit à interroger la manière, dont nous considérons la science du siècle des Lumières et à l’enrichir grâce à une figure comme Émilie du Châtelet. C’est aussi à cela que sert la discussion du canon (le corpus « officiel » des textes importants) de la philosophie des sciences.
Anne-Lise Rey est professeure de philosophie des sciences à l’université Paris-Nanterre.